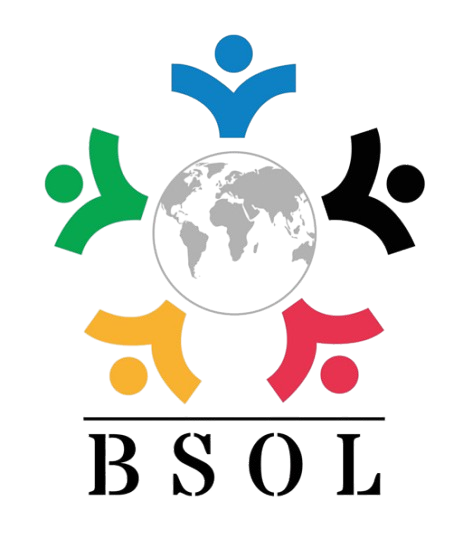Temps de lecture : 11 min.
« Vaillant, obéissant, bon citoyen et magnanime », telles étaient selon François de Sales quelques-unes des qualités de l’homme soucieux du bien public. La vaillance, expliquait-il, me fait « entreprendre par raison les choses périlleuses » ; l’obéissance est due «au prince que je sers » ; la magnanimité consiste « en la grandeur de cette action » que l’on entreprend en vue du bien commun. Enfin pour être « bon citoyen », il faut avoir « l’amour envers le public » et « l’affection envers sa patrie ». Même si le mot de citoyen ne désignait encore sous l’ancien régime que l’habitant d’une ville, on voit que l’expression « bon citoyen » était rattachée à « l’amour envers le public ».
Aimer et servir son pays
Le bon citoyen aime son pays, ce qui veut dire qu’il le préfère à tout autre « en affection », mais pas forcément « en estime », car rien n’empêche que l’on puisse reconnaître la valeur, voire la supériorité des autres, un peu comme il arrive dans le mariage :
Les femmes doivent préférer leurs maris à tout autre, non en honneur, mais en affection ; ainsi chacun préfère son pays en amour et non en estime, et chaque nocher chérit plus le vaisseau dans lequel il vogue que les autres, quoique plus riches et mieux fournis.
L’attachement aux siens, à sa famille, à son pays, à ses amis, à ses « brebis », se changeait en nostalgie quand il était au loin. C’est ainsi qu’en 1618, au début de son dernier séjour à Paris, il écrivait à l’une de ses correspondantes : « Je suis ici jusqu’à Pâques ; et croyez-moi, ma très chère fille, puisqu’il le faut, j’y suis de bon cœur, mais d’un cœur qui se plairait grandement d’être parmi nos petitesses et dans mon pays ».
L’amour du pays se confondait alors avec l’obéissance au prince et avec le service qui lui était dû. L’apprentissage de la fidélité au souverain et du service de l’État faisait partie de l’éducation. Ayant obtenu qu’un de ses neveux soit admis comme page à la cour de Turin, il estimait que cette faveur permettrait à ce garçon d’« apprendre en son enfance les premiers éléments de ce service auquel sa naissance l’oblige de faire l’emploi de toute sa vie ».
Même comme évêque, François de Sales se comportait en sujet fidèle, loyal et dévoué à la maison de Savoie. Quand il entrevoyait des périls, il en avertissait le duc ; il lui conseillait une alliance quand il la jugeait « extrêmement utile aux affaires » de son maître. Quand il apprit que le duc de Nemours complotait contre le duc de Savoie, il s’abstenait prudemment de le fréquenter, citant le « vieil enseignement » : « La place d’un évêque, c’est d’être dans sa bergerie et non à la cour », et terminant par cette brillante comparaison : « Je ne brûle point mes ailerons à ce flambeau ». Quand la Savoie était en danger, il le suppliait instamment d’apporter son courage « à la défense de ce sang, de cette maison, de cette couronne, de cet État ».
Cependant, si François de Sales est un serviteur fidèle, il n’est pas un courtisan adulateur et intéressé. Il y a en effet bien des façons de servir le prince :
Ceux qui servent les princes pour l’intérêt font ordinairement des services plus empressés, plus ardents et sensibles ; mais ceux qui servent par amour les font plus nobles, plus généreux, et par conséquent plus estimables.
Quoi qu’il en soit, François de Sales prônait l’obéissance comme la première vertu civique, certainement parce qu’il la considérait comme « une vertu morale qui dépend de la justice ». Il la recommandait à Philothée : « Vous devez obéir à vos supérieurs politiques, c’est-à-dire à votre prince et aux magistrats qu’il a établis sur votre pays ». Jusqu’à la fin de sa vie, François de Sales fit preuve de sens civique. C’est par obéissance au duc qu’il entreprit malgré son état de santé le dernier voyage, qui le conduisit à Avignon et à Lyon, où il mourut.
Dépasser certaines barrières sociales
La société dans laquelle vivait François de Sales était composée de couches très diversifiées, et qui plus est, séparées par des barrières. Il y avait « les ecclésiastiques, les nobles, ceux de robe longue, et le populas ou tiers état ».
Quand quelque chose allait mal, chacun rejetait la responsabilité sur les autres, disait-il dans un sermon : le peuple accuse la noblesse, la noblesse incrimine les « ministres de justice », ceux-ci dénoncent les soldats, les soldats rejettent la faute sur les capitaines, les capitaines dénigrent les princes. En conclusion, « il n’est permis de médire sans danger, en ce temps où nous sommes, de personne sinon de l’Église, de laquelle chacun est censeur, chacun la syndique (critique) ». La conclusion est obvie : que chacun s’examine et prenne ses responsabilités.
Si la division des citoyens est un mal qui peut produire le pire, l’union fait la force, comme dit le proverbe. « Les séditions et troubles intérieurs d’une république la ruinent entièrement et l’empêchent qu’elle ne puisse résister à l’étranger ». Quand il y avait des « dissensions et variétés de conceptions », il rappelait avec fermeté que « l’union et liaison des esprits » est « nécessaire à toute bonne entreprise ». Dans certains cas, le « bien de la ville » exigeait que certains renoncent à « leur particulière opinion » et que l’on se décide à « reprendre de nouveau le consentement du général, pour l’opposer au jugement des particuliers ».
Même aux religieuses de la Visitation il fallait rappeler le principe de l’égalité des personnes et dénoncer au besoin cette grande misère des honneurs : « On se surestime par-dessus les autres et l’on vient par après à dire : Je suis d’une telle maison et celle-là d’une autre ». Un jour, il leur raconta l’histoire de la fille d’un maréchal, qui ne pouvait se résoudre à appeler « sœur » une autre religieuse qui était de basse condition. Il fallait selon lui se dépouiller « du désir d’être estimé de bonne maison et quelque chose de plus que les autres ». Il s’écria même :
Oh ! nous sommes tous égaux, car nous sommes tous enfants de même père et de même mère, d’Adam et d’Ève ; c’est donc une grande folie de se glorifier de sa race.
Quand la justice est lésée
Un bon citoyen se caractérise par son sens de la justice. Malheureusement, les occasions de dénoncer les injustices ne manquent pas. François de Sales s’y employait fréquemment en chaire. C’est ainsi que dans sa fougue de jeune prédicateur, il s’en prit un jour à tour de rôle à diverses catégories de fraudeurs : l’artisan, « qui survend sa marchandise » ; le chicaneur, « qui sur un pied de mouche entretient un procès qui ruine l’âme, le corps et la maison de deux misérables parties » ; le juge, peu pressé de rendre la justice et « qui la fait si longue, s’excuse sur dix mille raisons de coutume, de style, de théorie, de pratique et de cautèle » ; l’usurier, qui se trompe lui-même en faisant mentir l’Écriture ; les prêtres, qui se flattent avec des dispenses pour servir deux maîtres ; et les dames, qui se plaisent d’être courtisées en « s’excusant qu’elles ne font point d’actes contraires à leur honneur ». Les pratiques commerciales, pensait-il, vont rarement sans tromperie, ce qui lui faisait dire que « les acheteurs et les vendeurs sont ordinairement voleurs, s’ils ne sont pas timorés et n’ont pas grand soin de veiller sur leur cœur ».
Dans certaines circonstances particulières, l’évêque savait fort bien que les bonnes paroles et les aumônes ne suffisaient pas ; il se faisait alors un devoir d’intervenir directement auprès des autorités compétentes pour défendre les droits des gens menacés. Car « il ne faut pas seulement se disposer à ne pas négliger l’innocent, écrivait-il, mais il faut se joindre à lui pour la défense de sa cause ».
En période de famine, il s’en prenait aux « dames qui tuent des moutons pour nourrir un petit chien couard et cagnard ». Durant les conflits armés, il sollicitait pour son « pauvre bon peuple » l’exemption des charges de guerre et appelait la protection et les aumônes du roi sur les catholiques du pays de Gex. La loi évangélique exclut toute guerre, rappelle François de Sales, qui ajoutait : « toutefois, la guerre est permise à cause de la malice des hommes : on peut repousser la force par la force ». Le pire, ce sont les gens qui en profitent, « qui s’y enrichissent et engraissent ».
La justice paraît souvent une gageure dans ce monde, toujours instable, qui bascule sans cesse entre l’enfer et le paradis. Si pour les chrétiens ces deux réalités font partie de l’au-delà, on en trouve toutefois des images suggestives ici-bas.
Lorsque quelqu’un vit dans « une calamiteuse république, tyrannisée » par un « roi maudit », c’est l’enfer ; les habitants y « souffrent des tourments indicibles » ; les yeux voient « l’horrible vision des diables et de l’enfer » ; les oreilles n’entendent jamais que « pleurs, lamentations et désespoirs ».
Le paradis, au contraire, c’est une « cité heureuse », où tout le monde vit « en la consolation d’une heureuse et indissoluble société ». Qu’il fait bon considérer « la noblesse, la beauté et la multitude des citoyens et habitants de cet heureux pays » ! Et François de s’écrier : « Oh ! que ce lieu est désirable et amiable, que cette cité est précieuse ! » ou encore : « Oh ! que cette compagnie est heureuse !»
Naturellement, la cité idéale n’existe pas sur la terre, mais ce n’est pas une raison pour ne pas travailler à la rendre un peu moins indigne d’un tel modèle. Justice et paix sont les biens que réclame la société civile et la « république chrétienne ». Or, « il faut céder à la nécessité du prochain », quand celui-ci les réclame à cor et à cri.
« La république tient à la religion » et «la religion tient à la république »
Homme d’Église avant tout, François de Sales se voulait étranger aux affaires directement politiques. En un temps de controverses avec les protestants où les catholiques et même nombre de religieux étaient portés vers la politique et les solutions politiques, il distinguait nettement les domaines, admettant une certaine forme d’autonomie du temporel. Il écrivait au gouverneur de Savoie :
Quant à moi, je vous proteste que j’ignore les affaires d’État, et les veux ignorer à tel point qu’elles ne soient ni en ma pensée, ni à mon soin, ni en ma bouche, sinon qu’il se présentât quelque occasion de témoigner à Son Altesse que je suis son passionné et fidèle sujet.
L’évêque voulait avant tout former de bons ministres de Dieu. Pour lui, le prêtre ne devait pas se mêler de questions temporelles et politiques. Il fera la même recommandation au futur cardinal Richelieu, qu’il rencontra à Tours en 1619 quand il n’était encore qu’évêque de Luçon, mais déjà secrétaire d’État. Il écrira à la mère de Chantal :
J’appris à connaître tout plein de prélats, et particulièrement M. l’évêque de Luçon, qui me jura toute amitié et me dit qu’enfin il se rangerait à mon parti, pour ne penser plus qu’à Dieu et au salut des âmes.
La suite montrera que ces bons propos ne dureront pas, ou du moins que le cardinal les interprètera à sa façon.
Fallait-il pour autant se désintéresser du bonheur temporel de ses compatriotes ? « Qui n’aime pas beaucoup la chose publique, ne se met pas beaucoup en peine si elle se ruine », écrit-il dans le Traité de l’amour de Dieu. La politique, d’ailleurs, n’est pas étrangère à la religion et à la conscience. À l’encontre du ministre protestant qui voulait séparer les deux domaines, sous prétexte que l’honneur n’est dû qu’à Dieu seul, l’auteur de la Défense de l’Étendard de la Sainte Croix répliquait « que c’est trop retrancher de l’honneur dû à Dieu d’en lever le civil et politique ».
François de Sales n’était donc pas tenté d’éliminer la religion de la vie publique. Tout en admettant une certaine laïcité de l’État, ou du moins une diversification des tâches civile et religieuse, il pensait que les princes avaient intérêt à réfléchir sur les avantages de la religion. De son côté, l’Église n’hésitait pas à « implorer » le secours du « bras séculier », surtout quand le catholicisme était menacé ou que la moralité était en péril.
Selon saint François de Sales, « la république tient à la religion comme le corps à l’âme, et la religion à la république comme l’âme au corps ». Union et distinction étaient les deux principes qui gouvernaient selon lui les rapports de l’Église et de l’État. L’idée de séparation n’entrait pas dans ce schéma, dont le modèle était dans les rapports du corps et de l’âme. Le malheur était que la politique se servait de la religion et que le pouvoir spirituel était comme inféodé au pouvoir temporel du prince. L’évêque de Genève s’en plaignait à son ami, l’évêque de Belley :
Quelle abjection que nous ayons le glaive spirituel en main et que, comme simples exécuteurs des volontés du magistrat temporel, il nous faille frapper quand il l’ordonne et cesser quand il le commande, et que nous soyons privés de la principale clef de celles que Notre-Seigneur nous a données, qui est celle du jugement, du discernement et de la science en l’usage de notre glaive !
Son attitude de sujet obéissant du duc de Savoie s’accompagnait d’un sens éclairé de ses propres droits. Il se considéra toujours comme prince de Genève, c’est-à-dire souverain temporel légitime de la ville dont Calvin et le parti huguenot avaient pris le contrôle. En décembre 1601, à la demande de Mgr de Granier, il avait rédigé un mémoire destiné à en fournir les preuves historiques. Le début, on ne peut plus clair, déclarait que l’évêque de Genève est « le seul légitime prince souverain de Genève et de ses dépendances, nonobstant que les seigneurs ducs de Savoie, comme successeurs des comtes de Genève d’une part et les citoyens de Genève de l’autre, prétendent le contraire ».
Enfin, pour garantir la paix des États et de l’Église, il valait mieux ne pas trop agiter certaines questions relatives à l’autorité du Saint-Siège dans les affaires temporelles, notamment en ce qui concernait le pouvoir du pape de déposer les rois. Lorsque Robert Bellarmin, « ce grand et célèbre cardinal », « ce très excellent théologien », écrivit sur l’ordre du pape que le pouvoir de celui-ci s’étendait aussi au temporel des rois, François de Sales ne fut pas content et il l’écrivit à l’un de ses amis de tendances gallicanes :
Non, je n’ai pas même trouvé à mon goût certains écrits d’un saint et très excellent prélat, esquels il a touché du pouvoir indirect du pape sur les princes ; non que j’aie jugé si cela est ou s’il n’est point, mais parce qu’en cet âge où nous avons tant d’ennemis dehors, je crois que nous ne devons rien émouvoir au dedans du corps de l’Église.
Citoyen du monde
L’éducation du bon citoyen dans une vision humaniste ne saurait se limiter à la petite patrie et l’une de ses tâches consiste à cultiver le sens de l’universel. La connaissance des autres peuples du monde était facilitée par l’établissement des premières cartes géographiques :
Ceux qui en quatre ou cinq feuilles de papier font voir Rome, Paris, Vienne et les plus grandes villes de France, marquent par de petits points quelles sont la grandeur et situation des lieux, encore que ce n’est rien en comparaison de ce qui en est ; mais ceux qui entendent et qui connaissent la géographie entendent par là ce que c’est de Paris, de Rome, de Vienne et autres.
Aimer son pays n’autorise pas le mépris des autres. L’auteur de l’Introduction met en garde contre une habitude où « chacun se donne liberté de juger et censurer les princes et de médire des nations toutes entières, selon la diversité des affections que l’on a en leur endroit ». D’après un de ses familiers, l’évêque de Genève « avait en horreur tout dénigrement et n’approuvait pas même qu’on fît allusion à ces vices que les auteurs attribuent d’ordinaire à certaines nations ».
Le chrétien surtout est ouvert par principe au monde entier : si je ne veux que la volonté de Dieu, s’exclamait-il, « que m’importe-t-il que l’on m’envoie en Espagne ou en Irlande ? Et si je ne cherche que sa croix, pourquoi me fâchera-t-il que l’on m’envoie aux Indes, aux terres neuves ou aux vieilles, puisque je suis assuré que je la trouverai partout ? »
Une façon concrète de s’ouvrir à l’universel est l’apprentissage des langues. Il admirait Mithridate, roi du Pont, qui, selon Pline, « savait vingt-deux langues ». Dans son oraison funèbre du duc de Mercœur, il louait ce grand personnage parce qu’il « avait aussi l’usage de l’éloquence et la grâce de bien exprimer ses belles conceptions, non seulement en cette notre langue française, mais même en allemande, italienne et espagnole » ; à la tête de ses troupes, il savait « parler à un chacun en sa propre langue, français, allemand, italien ».
Son ouverture à l’universel se fera sentir de plus en plus au fur et à mesure qu’il avancera en âge et en expérience. Vers la fin de sa vie, pour montrer sa parfaite indifférence face aux voyages et aux missions qui l’attendaient en dehors de la Savoie, il écrira cette déclaration significative : « Je ne suis plus de ce pays, ains du monde ».