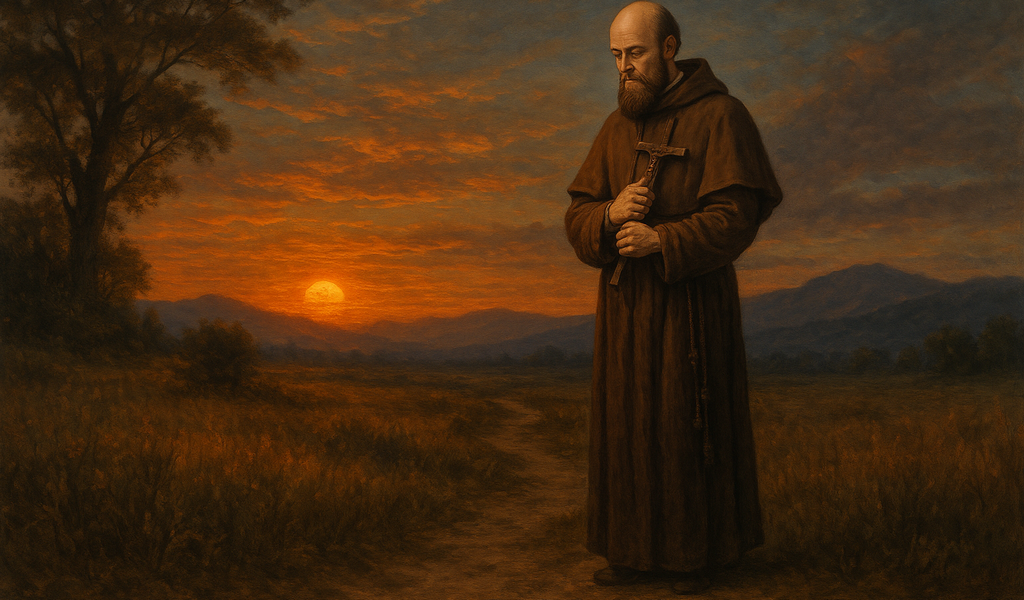Temps de lecture : 12 min.
Il semble bien que ce soit l’avènement de la réforme protestante qui ait mis à l’ordre du jour le problème de la conscience, et plus précisément de la « liberté de conscience ». Dans une lettre de 1597 à Clément VIII, le prévôt de Sales se plaignait au pape de la « tyrannie » que la « république de Genève » faisait peser « sur les consciences catholiques ». Il demandait au Saint-Siège d’intervenir auprès du roi de France pour qu’il obtienne que les Genevois accordent « ce qu’ils appellent liberté de conscience ». Hostile aux solutions militaires de la crise protestante, il laissait entrevoir dans la libertas conscientiae une issue possible à la confrontation violente, à condition que la réciprocité soit respectée. Revendiquée par Genève en faveur de la Réforme et revendiquée par François de Sales en faveur du catholicisme, la liberté de conscience allait devenir un des piliers de la mentalité moderne.
Dignité de la personne humaine
La dignité de l’individu réside dans sa conscience et la conscience signifie en premier lieu sincérité, honnêteté, franchise, conviction. Le prévôt de Sales avouait par exemple « pour la décharge de [sa] conscience » que le projet des Controverses lui avait été en quelque sorte imposé par autrui. Quand il apportait ses raisons en faveur de la doctrine et de la pratique catholiques, il prenait soin de dire qu’il le faisait « en conscience ». « Dites-moi en conscience », demandait-il avec insistance à ses contradicteurs. Quant à la « bonne conscience », c’est elle qui fait que l’on évite certains actes qui nous mettent en contradiction avec nous-mêmes.
Cependant la conscience subjective individuelle ne peut pas toujours être tenue comme garante de la vérité objective. On n’est pas toujours obligé de croire ce que quelqu’un vous dit en conscience. « Montrez-moi clairement, dit le prévôt aux messieurs de Thonon, que lorsque vous me dites que telle et telle inspiration se passe en votre conscience, vous ne mentez point, vous ne me trompez point ». La conscience peut être victime de l’illusion, de façon volontaire ou même involontaire. « Les plus avares, non seulement ne confessent pas de l’être, mais ils ne pensent pas en leur conscience de l’être ».
La formation de la conscience est une tâche essentielle, parce que la liberté comporte le risque de « faire le bien et le mal », mais « choisir le mal, ce n’est pas user mais abuser de notre liberté ». Tâche rude, parce que la conscience nous apparaît parfois comme un adversaire, mais c’est un bon adversaire qui « combat toujours contre nous et pour nous » : « il résiste toujours à nos mauvaises inclinations », mais il le fait pour notre bien. Quand l’homme pèche, « le reproche intérieur vient contre sa conscience avec l’épée au poing », mais c’est « pour l’outrepercer d’une sainte crainte ».
Un des moyens pour exercer une liberté responsable est de pratiquer « l’examen de conscience ». C’est faire comme les colombes qui « se mirent » « auprès des eaux très pures », et qui « se nettoient, purifient et ornent au mieux qu’elles peuvent ». Philothée est invitée à faire cet examen tous les soirs, en se demandant « comme on s’est comporté en toutes les heures du jour ; et pour faire cela aisément, on considérera où, avec qui, et en quelle occupation on a été ».
Une fois l’an, nous devrions faire un examen approfondi de « l’état de notre âme » envers Dieu, envers le prochain et envers nous-mêmes, sans oublier un « examen sur les affections de notre âme ». L’examen, dit-il aux visitandines, vous conduira à chercher « bien au fond de votre conscience ».
Comment décharger sa conscience quand on sent peser sur elle une erreur ou une faute ? Certains le font d’une mauvaise manière en jugeant et en accusant les autres « du vice auquel ils se sont voués », pensant ainsi « adoucir les remords de leurs consciences ». C’est ainsi qu’on multiplie le risque des jugements téméraires. Au contraire, « ceux qui ont bien soin de leurs consciences ne sont guère sujets au jugement téméraire ». Il faut mettre à part le cas des parents, des éducateurs et des responsables du bien public car « une bonne partie de leur conscience consiste à regarder et veiller sur celle des autres ».
Le respect de soi
La conscience exige le respect de soi et des autres. De l’affirmation de la dignité et de la responsabilité de chacun devra naître le respect de soi. Déjà Socrate et toute l’antiquité païenne et chrétienne avaient montré le chemin :
C’est une parole des philosophes, mais qui a été approuvée pour bonne par les docteurs chrétiens : « Connais-toi toi-même », c’est-à-dire, connais l’excellence de ton âme afin de ne la point avilir ni mépriser.
Certains de nos actes constituent non seulement une offense à Dieu, mais aussi une offense à la dignité de l’homme, à sa raison. Leurs conséquences sont déplorables : « La ressemblance et image de Dieu que nous avons est barbouillée et défigurée, la dignité de notre esprit déshonorée », nous sommes rendus « semblables aux bêtes insensées, nous rendant esclaves de nos passions et renversant l’ordre de la raison ».
Il y a des extases et des ravissements qui nous élèvent au-dessus de notre condition naturelle, et d’autres qui nous rabaissent : « Ô hommes, s’écrie l’auteur du Traité de l’amour de Dieu, jusques à quand serez-vous si insensés que de vouloir ravaler votre dignité naturelle, descendant volontairement et vous précipitant en la condition des bêtes brutes » ?
Le respect de soi permettra d’éviter ces deux périls opposés que sont l’orgueil et la dépréciation des dons qui sont en nous. En un siècle où le sens de l’honneur était exalté au maximum, François de Sales a dû intervenir pour dénoncer ses méfaits, notamment dans la question du duel, qui faisait « hérisser les cheveux en tête » à l’évêque de Genève, et plus encore l’orgueil insensé qui en était la cause. « Je suis scandalisé, écrit-il à l’épouse d’un mari duelliste ; en vérité, je ne puis penser comme l’on peut avoir un courage si déréglé, même pour des bagatelles et choses de rien ». En se battant en duel, c’est comme « s’ils s’étaient entreservis de bourreau l’un à l’autre ».
D’autres, à l’inverse, n’osent pas reconnaître les dons qu’ils ont reçus et manquent ainsi au devoir de reconnaissance. François de Sales dénonce « certaine fausse et niaise humilité qui leur empêche de regarder rien en eux qui soit bon ». Ils ont tort car « les biens que Dieu met en nous veulent être reconnus, estimés et grandement honorés ».
Le premier prochain que je dois respecter et aimer, semble vouloir dire François de Sales, c’est moi-même. Le véritable amour envers moi-même et le respect que je me dois veulent que je tende à la perfection et que je me corrige, s’il en est besoin, mais avec douceur, raisonnablement et plutôt « par voie de compassion » que par colère et avec emportement.
Il existe en effet un amour de soi qui est non seulement légitime, mais bienfaisant et commandé : « Charité bien ordonnée commence par soi-même », dit le proverbe, et c’est bien la pensée de François de Sales, à condition de ne pas confondre l’amour de soi et l’amour-propre. L’amour de soi est bon en lui-même. Philothée est invitée à s’interroger sur la façon dont elle s’aime elle-même :
Tenez-vous bon ordre en l’amour de vous-même ? car il n’y a que l’amour désordonné de nous-mêmes qui nous ruine. Or, l’amour ordonné veut que nous aimions plus l’âme que le corps, que nous ayons plus de soin d’acquérir les vertus que toute autre chose.
Au contraire, l’amour-propre est un amour égoïste, narcissique, replié sur lui-même, jaloux de sa propre beauté et uniquement préoccupé de son intérêt : « Narcisse, disent les profanes, était un enfant si dédaigneux qu’il ne voulut jamais donner son amour à personne ; mais enfin en se regardant dans une claire fontaine, il fut extrêmement épris de sa beauté. »
Le « respect que l’on doit aux personnes »
Si l’on se respecte soi-même on sera plus porté à respecter les autres. Le fait que nous sommes l’image de Dieu a pour corollaire l’affirmation que « tous les hommes ont cette même dignité ». Tout en vivant lui-même dans une société d’ancien régime, fortement inégalitaire, François de Sales a promu une pensée et une pratique du « respect que l’on doit aux personnes ».
Il faut commencer par l’enfant. La mère de saint Bernard, dit l’auteur de l’Introduction, aimait ses enfants à peine nés « avec respect comme chose sacrée et que Dieu lui avait confiée ». Un reproche très grave adressé par François de Sales aux païens était leur mépris de la vie des êtres sans défense. Le respect de l’enfant à naître s’exprime dans ce passage d’une lettre à une femme enceinte écrite selon la rhétorique baroque de l’époque. Il l’encourage en lui expliquant que l’« enfant qui se forme au milieu de [ses] entrailles est non seulement « une image vivante de la divine Majesté », mais aussi l’image de sa mère. Il recommandait à une autre :
Offrez souvent à la gloire éternelle de notre Créateur la petite créature à la formation de laquelle il vous a voulu prendre pour coopératrice.
Un autre aspect du respect d’autrui concerne le respect de sa liberté. La découverte de nouvelles terres avait eu pour conséquence néfaste la résurgence de l’esclavage, qui ne rappelait que trop les pratiques des anciens Romains au temps du paganisme. La vente d’êtres humains ravalait ceux-ci au rang des bêtes :
Marc Antoine acheta un jour deux jeunes jouvenceaux que lui présenta un certain maquignon ; car en ce temps-là, comme il se fait encore en quelques contrées, l’on vendait les enfants : il y avait des hommes qui en faisaient provision et usaient de ce trafic comme l’on fait des chevaux en nos pays.
De manière plus subtile, le respect d’autrui est continuellement menacé par la médisance et la calomnie. François de Sales insiste beaucoup sur les « péchés de langue ». Un chapitre de l’Introduction traite explicitement « de l’honnêteté des paroles et du respect que l’on doit aux personnes ». Ruiner la réputation de quelqu’un, c’est commettre un « homicide spirituel » ; c’est ôter « la vie civile » à celui duquel on médit. Aussi, « en blâmant le vice », on s’efforcera d’épargner le plus possible « la personne en laquelle il est ».
Certaines catégories de personnes sont facilement dénigrées ou méprisées. François de Sales défend la dignité des hommes du peuple en s’appuyant sur l’Évangile : « Saint Pierre, commente-t-il, était un homme rude, grossier, un viel pêcheur, métier mécanique, et d’une basse condition ; saint Jean, au contraire, était un jeune gentilhomme, doux, agréable, savant ; saint Pierre ignorant. » Or, c’est saint Pierre qui fut choisi pour conduire les autres et être le « supérieur universel ».
Il proclame la dignité des malades, disant que « les âmes qui sont en croix sont déclarées reines ». Dénonçant la « cruauté envers les pauvres » et exaltant la « dignité des pauvres », il justifie et précise l’attitude qu’il faut avoir envers eux en expliquant « combien nous devons les honorer, et partant les visiter comme représentant Notre-Seigneur ». Personne n’est inutile, personne n’est insignifiant : « Il n’y a nulle si mauvaise pièce au monde qui ne soit utile a quelque chose ; mais il faut lui trouver son usage et son lieu ».
L’« unidivers » salésien
Le problème qui a toujours tourmenté les sociétés humaines a été celui de concilier la dignité et la liberté de chaque individu avec celles des autres. Il reçoit chez François de Sales un éclairage original grâce à l’invention d’un mot nouveau. En effet, étant donné que l’univers est formé de « toutes choses créées tant visibles qu’invisibles » et que « toute leur diversité se réduit en unité », il propose de l’appeler « unidivers », c’est-à-dire « unique et divers, unique avec diversité et divers avec unité ».
Pour lui, chaque être est unique. Les personnes sont comme les perles dont parle Pline : « elles sont tellement uniques une chacune en ses qualités, qu’il ne s’en trouve jamais deux qui soient parfaitement pareilles ». Il est significatif que ses deux ouvrages principaux, l’Introduction et le Traité, s’adressent à une personne individuelle, Philothée et Théotime. Que de variété et de diversité entre les êtres ! « Certes, comme nous voyons qu’il ne se trouve jamais deux hommes semblables ès dons naturels, aussi ne s’en trouve-t-il jamais de parfaitement égaux ès surnaturels ». La variété l’enchantait même d’un point de vue purement esthétique, mais il craignait une curiosité indiscrète sur les causes :
Si quelqu’un s’enquérait pourquoi Dieu fait les melons plus gros que les fraises, ou les lis plus grands que les violettes, pourquoi le romarin n’est pas une rose, ou pourquoi l’œillet n’est pas un souci, pourquoi le paon est plus beau qu’une chauve-souris, ou pourquoi la figue est douce et le citron aigrelet, on se moquerait de ses demandes et on lui dirait : Pauvre homme, puisque la beauté du monde requiert la variété, il faut qu’il y ait des différentes et inégales perfections ès choses, et que l’une ne soit pas l’autre ; c’est pourquoi les unes sont petites, les autres grandes, les unes aigres, les autres douces, les unes plus, et les autres moins belles. […] Toutes ont leur prix, leur grâce et leur émail, et toutes, en l’assemblage de leurs variétés, font une très agréable perfection de beauté.
La diversité n’empêche pas l’unité, bien plus elle l’enrichit et l’embellit. Chaque fleur a ses caractéristiques propres qui la distinguent de toutes les autres : « Ce n’est pas le propre des roses d’être blanches, ce me semble, car les vermeilles sont plus belles et de meilleure odeur ; c’est néanmoins le propre du lys ». Certes, François de Sales ne supporte pas la confusion et le désordre, mais il est également ennemi de l’uniformité. La diversité des êtres peut conduire à la dispersion et à la rupture de la communion, mais s’il y l’amour, « lien de la perfection », rien n’est perdu, au contraire la diversité est magnifiée dans la communion.
S’il y bien chez François de Sales une réelle culture de l’individu, celle-ci ne vise pas toutefois une fermeture au groupe, à la communauté ou à la société. Il voit spontanément l’individu inséré dans un milieu ou « état » de vie, qui marque fortement l’identité et l’appartenance de chacun. On ne pourra pas fixer un programme ou un projet de vie égal pour tous, tout simplement parce qu’il sera appliqué et mis en œuvre différemment « par le gentilhomme, par l’artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mariée » ; il faut en outre l’adapter « aux forces, aux affaires et aux devoirs de chaque particulier ». François de Sales voit la société répartie en milieux de vie fortement marqués par l’appartenance sociale et les solidarités de groupe, comme lorsqu’il traite « de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés ».
L’amour personnalise, et donc individualise. L’affection qui lie une personne à une autre est unique, comme l’éprouva François de Sales au contact de madame de Chantal :
Chaque affection a sa particulière différence d’avec les autres ; celle que je vous ai a une certaine particularité qui me console infiniment, et, pour dire tout, qui m’est extrêmement profitable.
Le soleil luit pour tous et pour chacun : « éclairant un endroit de la terre [il] ne l’éclaire pas moins que s’il n’éclairait point ailleurs et qu’il éclairât cela seul ».
L’être humain est en devenir
Humaniste chrétien, François de Sales croit enfin à la nécessité et à la possibilité du perfectionnement de la personne humaine. Érasme avait forgé la formule : Homines non nascuntur sed finguntur. Alors que l’animal est un être prédéterminé, guidé par l’instinct, l’homme au contraire est en perpétuelle évolution. Non seulement il change, mais il peut se changer lui-même, soit en mieux soit en pire.
Toute la préoccupation de François de Sales fut de se perfectionner lui-même, et d’aider les autres à se perfectionner, non seulement dans le domaine religieux, mais en toute chose. De la naissance à la tombe, l’homme est en apprentissage. Faisons comme le crocodile qui « ne cesse jamais de croître tandis qu’il est en vie ». En effet, « de demeurer en un état de consistance longuement, il est impossible : qui ne gagne, perd en ce trafic ; qui ne monte, descend en cette échelle ; qui n’est vainqueur, est vaincu en ce combat ». Il cite saint Bernard qui disait : « Il est écrit très spécialement de l’homme, que jamais il n’est en un même état : il faut ou qu’il avance, ou qu’il retourne en arrière ». Il faut avancer :
Ne connais-tu pas que tu es au chemin, et que le chemin n’est pas fait pour s’asseoir mais pour marcher ? Et il est tellement fait pour marcher, que marcher s’appelle cheminer.
Cela signifie aussi que la personne est éducable, capable d’apprendre, de se corriger et de s’améliorer. Cela est vrai à tous les niveaux. L’âge parfois n’y fait rien. Voyez ces petits chanteurs de la cathédrale, qui dépassent déjà de loin les capacités de l’évêque dans leur domaine :
J’admire ces petits enfants, qui à peine savent parler et qui chantent déjà leur partie, entendant toutes ces notes et ces règles de musique où je ne pense pas que je puisse rien comprendre, moi qui suis homme fait et qu’on voudrait bien faire passer pour quelque grand personnage.
Personne dans ce bas monde n’est parfait :
Il y en a qui de leurs naturels sont légers, les autres rébarbatifs, les autres durs à recevoir les opinions d’autrui, les autres sont inclinés à l’indignation, les autres à la colère, les autres à l’amour ; et en somme, il se trouve peu de personnes esquelles on ne puisse remarquer quelques sortes de telles imperfections.
Faut-il donc désespérer de pouvoir améliorer son tempérament en corrigeant quelques-unes de nos inclinations naturelles ? Nullement :
Quoiqu’elles soient comme propres et naturelles à un chacun, si est-ce que par le soin et affection contraire on les peut corriger et modérer, et même on peut s’en délivrer et purger : et je vous dis, Philothée, qu’il le faut faire. On a bien trouvé le moyen de changer les amandiers amers en amandiers doux, en les perçant seulement au pied pour en faire sortir le suc ; pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas faire sortir nos inclinations perverses pour devenir meilleurs ?
D’où la conclusion optimiste mais exigeante : « Il n’y a point de si bon naturel qui ne puisse être rendu mauvais par les habitudes vicieuses ; il n’y a point aussi de naturel si revêche qui, par la grâce de Dieu premièrement, puis par l’industrie et diligence, ne puisse être dompté et surmonté ». Si l’homme est éducable, il ne faut désespérer de personne et se garder des jugements tout faits sur les personnes :
Ne dites pas : un tel est un ivrogne, encore que vous l’ayez vu ivre ; ni, il est adultère, pour l’avoir vu en ce péché ; ni, il est inceste, pour l’avoir trouvé en ce malheur ; car un seul acte ne donne pas le nom à la chose. […] Encore qu’un homme ait été vicieux longuement, on court fortune de mentir quand on le nomme vicieux.
L’homme n’a jamais fini de cultiver sa conscience, qui est son jardin secret. C’est la leçon que le fondateur des visitandines leur inculquait quand il les appelait « à cultiver la terre et le jardin » de leurs cœurs et de leurs esprits, car il n’existe pas d’« homme si parfait qui n’ait besoin de travailler, tant pour accroître la perfection que pour la conserver ».