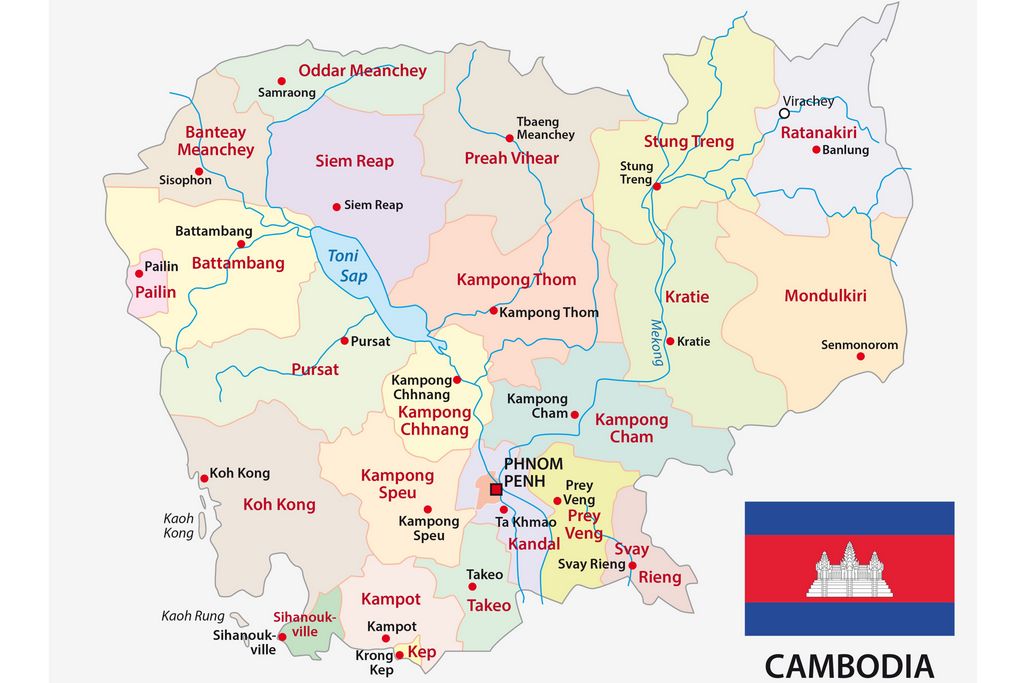Le cœur d’or de l’éducation
Pourquoi la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus fait-elle partie de l’ADN de la Congrégation salésienne ?
Une belle église qui a coûté « du sang et des larmes » à Don Bosco, qui, déjà rongé par la fatigue, a consacré ses dernières énergies et ses dernières années à la construction de ce temple demandé par le Pape.
C’est aussi un lieu cher à tous les salésiens pour bien d’autres raisons.
La statue dorée du clocher, par exemple, est un signe de reconnaissance : elle a été offerte par d’anciens élèves argentins pour remercier les salésiens d’être venus sur leur terre.
Et aussi parce que, dans une lettre de 1883, Don Bosco a écrit cette phrase mémorable : « Souvenez-vous que l’éducation est une affaire de cœur, que Dieu seul en est le maître, et que nous ne pourrons rien réussir si Dieu ne nous en enseigne pas l’art et ne nous en donne pas les clefs dans les mains ». La lettre se terminait ainsi : « Priez pour moi, et croyez toujours au Sacré-Cœur de Jésus ».
Car la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus fait partie de l’ADN salésien.
La fête du Sacré-Cœur de Jésus veut nous encourager à avoir un cœur vulnérable. Seul un cœur qui peut être blessé est capable d’aimer. Ainsi, en cette fête, nous contemplons le cœur ouvert de Jésus pour ouvrir nos cœurs à l’amour. Le cœur est le symbole ancestral de l’amour et de nombreux artistes ont peint en or la blessure du cœur de Jésus. Du cœur ouvert rayonne vers nous l’éclat doré de l’amour, et la dorure nous montre aussi que nos labeurs et nos blessures peuvent se transformer en quelque chose de précieux.
Chaque temple et chaque dévotion au Sacré-Cœur de Jésus parle de l’amour de ce cœur divin, le cœur du Fils de Dieu, pour chacun de ses fils et filles de cette humanité. Et cela parle de douleur, cela parle d’un amour de Dieu qui n’est pas toujours réciproque. Aujourd’hui, j’ajoute un autre aspect. Je pense qu’il parle aussi de la douleur de ce Seigneur Jésus face à la souffrance de nombreuses personnes, la mise à l’écart d’autres personnes, l’immigration d’autres personnes sans horizon, la solitude, la violence que de nombreuses personnes subissent.

Je pense que l’on peut dire qu’elle parle de tout cela et qu’en même temps elle bénit, sans aucun doute, tout ce qui est fait en faveur des plus petits, c’est-à-dire la même chose que Jésus lorsqu’il parcourait les routes de Judée et de Galilée.
C’est pourquoi c’est un beau signe que la Maison du Sacré-Cœur soit aujourd’hui le siège de la Congrégation.
Autant de cœurs d’argent
L’une de ces joyeuses réalités qui réjouissent sans aucun doute le « Cœur de Dieu lui-même » est celle que j’ai pu voir de mes propres yeux, à savoir ce qui se fait à la Fondation salésienne Don Bosco sur les îles de Ténériffe et de Grande Canarie. J’y étais la semaine dernière et, parmi les nombreuses choses que j’ai vécues, j’ai pu voir les 140 éducateurs qui travaillent dans les différents projets de la Fondation (accueil, logement, formation professionnelle et placement ultérieur). Et puis j’ai rencontré une centaine d’autres adolescents et jeunes qui bénéficient de ce service de Don Bosco pour les plus petits. A la fin de notre précieuse rencontre, ils m’ont offert un cadeau.
J’étais ému parce qu’en 1849, deux jeunes garçons, Carlo Gastini et Felice Reviglio, avaient eu la même idée et, dans le plus grand secret, en économisant sur la nourriture et en gardant jalousement leurs petits pourboires, ils avaient réussi à acheter un cadeau pour la fête patronale de Don Bosco. La nuit de la Saint-Jean, ils étaient allés frapper à la porte de la chambre de Don Bosco. Imaginez son émerveillement et son émotion lorsqu’on lui présenta deux petits cœurs en argent, accompagnés de quelques mots maladroits.
Le cœur des jeunes est toujours le même et aujourd’hui encore, aux Canaries, dans une petite boîte en carton en forme de cœur, ils ont déposé plus de cent cœurs avec les noms de Nain, Rocio, Armiche, Mustapha, Joussef, Ainoha, Desiré, Abdjalil, Béatrice et Ibrahim, Yone et Mohamed et cent autres, exprimant simplement quelque chose qui vient du cœur ; des choses sincères et de grande valeur comme celles-ci :
– Merci d’avoir rendu cela possible.
– Merci pour la seconde chance que vous m’avez donnée dans la vie.
– Je continue à me battre. Avec vous, c’est plus facile.
– Merci de m’avoir redonné de la joie.
– Merci de m’aider à croire que je peux faire tout ce que je veux.
– Merci pour la nourriture et la maison.
– Merci du fond du cœur.
– Merci de m’avoir aidée.
– Merci de m’avoir donné l’occasion de grandir.
– Merci de croire en nous, les jeunes, malgré notre situation….
Et des centaines d’expressions similaires, adressées à Don Bosco et aux éducateurs qui, au nom de Don Bosco, les accompagnent chaque jour.
J’ai écouté ce qu’ils m’ont raconté, j’ai entendu quelques-unes de leurs histoires (souvent pleines de douleur), j’ai vu leurs regards et leurs sourires, et je me suis senti très fier d’être salésien et d’appartenir à une si belle famille de frères, d’éducateurs et de jeunes.
J’ai pensé, une fois de plus, que Don Bosco est plus actuel et nécessaire que jamais ; j’ai pensé à la finesse éducative avec laquelle nous accompagnons tant de jeunes dans le respect et la sensibilité de leurs rêves.
Ensemble, nous avons récité une prière adressée au Dieu qui nous aime tous, au Dieu qui bénit ses fils et ses filles. Une prière qui a mis à l’aise les chrétiens, les musulmans et les hindous. À ce moment-là, sans aucun doute, l’Esprit de Dieu nous embrassait tous.
J’étais heureux parce que, tout comme Don Bosco a accueilli ses premiers garçons au Valdocco, la même chose se produit aujourd’hui dans de nombreux Valdocco du monde entier.
Lorsque nous parlons de l’amour de Dieu, il s’agit pour beaucoup d’un concept trop abstrait. Dans le Sacré-Cœur de Jésus, l’amour de Dieu pour nous est devenu concret, visible et perceptible. Pour nous, Dieu a pris un cœur humain et, dans le cœur de Jésus, il nous a ouvert son cœur. Ainsi, par Jésus, nous pouvons amener nos destinataires au cœur de Dieu.